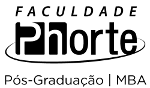11 resultados para Voltaire
em Université de Lausanne, Switzerland
Resumo:
RESUME : Cette étude est une analyse métrique et stylistique de La Pulcella d'Orléans de Vincenzo Monti - traduction-réécriture de l'homonyme poème de Voltaire, La Pucelle d'Orléans - commencée à Milan en 1798 et terminée à Chambéry, en Savoie, en 1799. Le texte italien a été considéré comme une version autonome par rapport au texte français, étant donné le particulier choix de réduire la composante philosophique et idéologique d'origine, et de mettre en relation le modèle avec une littérature italienne spécifique, principalement par l'adoption d'une grille strophique fortement marquée. La Pulcella est traduite en octaves, un mètre chevaleresque qui possède au moins depuis trois siècles sa propre "grammaire" ainsi qu'une formidable tradition de référence. De plus, avec sa traduction, l'auteur a voulu mettre l'accent sur les aspects de l'histoire les plus amusantes et provocatrices de Jeanne d'Arc - déjà narrée par Voltaire avec un ton ironique et irrévérencieux - dans le but d'une grande expérimentation au niveau de la langue, de la métrique et de la syntaxe. La traduction de la Pucelle est en effet liée à une dimension hédonistique et livresque: elle n'est pas un prétexte pour connaitre une oeuvre étrangère, ni un texte conçu pour être publiée; il s'agit plutôt d'un exercice personnel, un divertissement privé, demeuré dans le tiroir de l'auteur. Alors que pour Voltaire le but principal du poème est la polémique idéologique du fond, exprimée par un registre fort satirique, pour Monti la réécriture est un jeu stylistique, une complaisance littéraire, qui repose autant sur les composantes désacralisantes et provocatrices que sur les éléments poétiques et idylliques. Le modèle français est donc retravaillé, en premier lieu, au niveau du ton: d'un côté la traduction réduit l'horizon idéologique et la perspective historique des événements; de l'autre elle accroît les aspects les plus hédonistiques et ludiques de Voltaire, par la mise en évidence de l'élément comique, plus coloré et ouvert. En raison de la dimension intime de cette traduction, de nos jours la tradition de la Pulcella italienne se fonde sur trois témoins manuscrits seulement, dont un retrouvé en 1984 et qui a rouvert le débat philologique. Pour ma thèse j'ai utilisé l'édition critique qu'on possède à présent, imprimée en 1982 sous la direction de M. Mari et G. Barbarisi, qui se fonde seulement sur deux témoins du texte; de toute façon mon travail a essayé de considérer aussi en compte le nouvel autographe découvert. Ce travail de thèse sur la Pulcella est organisé en plusieurs chapitres qui reflètent la structure de l'analyse, basée sur les différents niveaux d'élaboration du texte. Au début il y a une introduction générale, où j'ai encadré les deux versions, la française et l'italienne, dans l'histoire littéraire, tout en donnant des indications sur la question philologique relative au texte de Monti. Ensuite, les chapitres analysent quatre aspects différents de la traduction: d'abord, les hendécasyllabes du poème: c'est à dire le rythme des vers, la prosodie et la distribution des différents modules rythmiques par rapport aux positions de l'octave. La Pucelle de Voltaire est en effet écrite en décasyllabes, un vers traditionnellement assez rigide à cause de son rythme coupé par la césure; dans la traduction le vers français est rendu par la plus célèbre mesure de la tradition littéraire italienne, l'endécasyllabe, un vers qui correspond au décasyllabe seulement pour le nombre de syllabes, mais qui présente une majeure liberté rythmique pour la disposition des accents. Le deuxième chapitre considère le mètre de l'octave, en mettant l'accent sur l'organisation syntaxique interne des strophes et sur les liens entre elles ; il résulte que les strophes sont traitées de manière différente par rapport à Voltaire. En effet, au contraire des octaves de Monti, la narration française se développe dans chaque chant en une succession ininterrompue de vers, sans solutions de continuité, en délinéant donc des structures textuelles très unitaires et linéaires. Le troisième chapitre analyse les enjambements de la Pulcella dans le but de dévoiler les liaisons syntactiques entre les verses et les octaves, liaisons presque toujours absentes en Voltaire. Pour finir, j'ai étudié le vocabulaire du poème, en observant de près les mots les plus expressives quant à leur côté comique et parodique. En effet, Monti semble exaspérer le texte français en utilisant un vocabulaire très varié, qui embrasse tous les registres de la langue italienne: de la dimension la plus basse, triviale, populaire, jusqu'au niveau (moins exploité par Voltaire) lyrique et littéraire, en vue d'effets de pastiche comique et burlesque. D'après cette analyse stylistique de la traduction, surgit un aspect très intéressant et unique de la réécriture de Monti, qui concerne l'utilisation soit de l'endécasyllabe, soit de l'octave, soit du vocabulaire du texte. Il s'agit d'un jeu constant sur la voix - ou bien sur une variation continue des différents plans intonatives - et sur la parole, qui devient plus expressive, plus dense. En effet, la lecture du texte suppose une variation mélodique incessante entre la voix de l'auteur (sous forme de la narration et du commentaire) et la voix de personnages, qu'on entend dans les nombreux dialogues; mais aussi une variation de ton entre la dimension lexical littéraire et les registres les plus baissés de la langue populaire. Du point de vue de la syntaxe, par rapport au modèle français (qui est assez monotone et linéaire, basé sur un ordre syntactique normal, sur le rythme régulier du decasyllabe et sur un langage plutôt ordinaire), Monti varie et ennoblit le ton du discours à travers des mouvements syntaxiques raffinés, des constructions de la période plus ou moins réguliers et l'introduction de propositions à cheval des vers. Le discours italien est en effet compliquée par des interruptions continues (qui ne se réalisent pas dans des lieux canoniques, mais plutôt dans la première partie du vers ou en proximité de la pointe) qui marquent des changements de vitesse dans le texte (dialogues, narration, commentaires): ils se vérifient, en somme, des accélérations et des décélérations continues du récit ainsi qu'un jeu sur les ouvertures et fermetures de chaque verse. Tout se fait à travers une recherche d'expressivité qui, en travaillant sur la combinaison et le choc des différents niveaux, déstabilise la parole et rend l'écriture imprévisible.
Resumo:
La présente recherche se propose de désobstruer un certain nombre de catégories « esthétiques », au sens étendu du terme, de leur métaphysique implicite. La thèse que je souhaite défendre se présente sous la forme d'un paradoxe : d'une part, le sens originel d'« esthétique » a été perdu de vue, d'autre part, malgré cet oubli, quiconque s'interroge philosophiquement sur les beaux-arts reçoit, nolens volens, Baumgarten en héritage. Avec AEsthetica (1750/1758), ouvrage inachevé et hautement problématique, nous pourrions dire, citant René Char, qu'il s'agit-là d'un « héritage précédé d'aucun testament ». En d'autres termes, ce qui nous échoit nous occupe, voire nous préoccupe, sans que nous disposions des outils conceptuels pour nous y rapporter librement. Soyons clairs, je ne soutiens pas que l'esthétique philosophique, telle qu'elle s'énonce à ses débuts, soit un passage obligé pour penser l'art, et ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un passage, mais proprement d'une impasse. Ce que je veux dire, c'est que Kant répond à Baumgarten, et que Hegel répond à Kant et ainsi de suite. Il n'y a pas de tabula rasa dans l'histoire de la pensée, et l'oubli de l'historicité d'une pensée est le meilleur moyen de la neutraliser en simple supplément culturel, tout en demeurant entièrement captifs de ses présupposés.Au départ, la question qui motivait implicitement la rédaction de cette recherche se formulait ainsi : « Dans quelle mesure la philosophie énonce-t-elle quelque chose d'important au sujet des beaux-arts ? » Au fil du temps, la question s'est inversée pour devenir : « Qu'est-ce que les écrits sur les beaux- arts, tels qu'ils foisonnent au 18e siècle, nous enseignent à propos de la philosophie et des limites inhérentes à sa manière de questionner ?» Et gardons-nous de penser qu'une telle inversion cantonne la question de l'esthétique, au sens très large du terme, à n'être qu'une critique immanente à l'histoire de la philosophie. Si la philosophie était une « discipline » parmi d'autres, un « objet » d'étude possible dans la liste des matières universitaires à choix, elle ne vaudrait pas, à mon sens, une seule heure de peine. Mais c'est bien parce que la philosophie continue à orienter la manière dont nous nous rapportons au « réel », au « monde » ou à l'« art » - je place les termes entre guillemets pour indiquer qu'il s'agit à la fois de termes usuels et de concepts philosophiques - que les enjeux de la question de l'esthétique, qui est aussi et avant tout la question du sentir, excèdent l'histoire de la philosophie.Pour introduire aux problèmes soulevés par l'esthétique comme discipline philosophique, j'ai commencé par esquisser à grands traits la question du statut de l'image, au sens le plus général du terme. Le fil conducteur a été celui de l'antique comparaison qui conçoit la poésie comme une « peinture parlante » et la peinture comme une « poésie muette ». Dans le prolongement de cette comparaison, le fameux adage ut pictura poesis erit a été conçu comme le véritable noeud de toute conception esthétique à venir.Il s'est avéré nécessaire d'insister sur la double origine de la question de l'esthétique, c'est-à-dire la rencontre entre la pensée grecque et le christianisme. En effet, l'un des concepts fondamentaux de l'esthétique, le concept de création et, plus spécifiquement la possibilité d'une création ex nihiio, a été en premier lieu un dogme théologique. Si j'ai beaucoup insisté sur ce point, ce n'est point pour établir une stricte identité entre ce dogme théologique et le concept de création esthétique qui, force est de l'admettre, est somme toute souvent assez flottant dans les écrits du 18e siècle. L'essor majeur de la notion de création, couplée avec celle de génie, sera davantage l'une des caractéristiques majeures du romantisme au siècle suivant. La démonstration vise plutôt à mettre en perspective l'idée selon laquelle, à la suite des théoriciens de l'art de la Renaissance, les philosophes du Siècle des Lumières ont accordé au faire artistique ou littéraire une valeur parfaitement inédite. Si l'inventeur du terme « esthétique » n'emploie pas explicitement le concept de création, il n'en demeure pas moins qu'il attribue aux poètes et aux artistes le pouvoir de faire surgir des mondes possibles et que ceux-ci, au même titre que d'autres régions de l'étant, font l'objet d'une saisie systématique qui vise à faire apparaître la vérité qui leur est propre. Par l'extension de l'horizon de la logique classique, Baumgarten inclut les beaux-arts, à titre de partie constituante des arts libéraux, comme objets de la logique au sens élargi du terme, appelée « esthético- logique ». L'inclusion de ce domaine spécifique d'étants est justifiée, selon les dires de son auteur, par le manque de concrétude de la logique formelle. Or, et cela n'est pas le moindre des paradoxes de l'esthétique, la subsomption des beaux-arts sous un concept unitaire d'Art et la portée noétique qui leur est conférée, s'opère à la faveur du sacrifice de leur singularité et de leur spécificité. Cela explique le choix du titre : « métaphysique de l'Art » et non pas « métaphysique de l'oeuvre d'art » ou « métaphysique des beaux-arts ». Et cette aporîe constitutive de la première esthétique est indépassable à partir des prémices que son auteur a établies, faisant de la nouvelle discipline une science qui, à ce titre, ne peut que prétendre à l'universalité.Au 18e siècle, certaines théories du beau empruntent la voie alternative de la critique du goût. J'ai souhaité questionner ces alternatives pour voir si elles échappent aux problèmes posés par la métaphysique de l'Art. Ce point peut être considéré comme une réplique à Kant qui, dans une note devenue célèbre, soutient que « les Allemands sont les seuls à se servir du mot "esthétique" pour désigner ce que d'autres appellent la critique du goût ». J'ai démontré que ces deux termes ne sont pas synonymes bien que ces deux positions philosophiques partagent et s'appuient sur des présupposés analogues.La distinction entre ces deux manières de penser l'art peut être restituée synthétiquement de la sorte : la saisie systématique des arts du beau en leur diversité et leur subsomption en un concept d'Art unitaire, qui leur attribue des qualités objectives et une valeur de vérité indépendante de toute saisie subjective, relègue, de facto, la question du jugement de goût à l'arrière-plan. La valeur de vérité de l'Art, définie comme la totalité des qualités intrinsèques des oeuvres est, par définition, non tributaire du jugement subjectif. Autrement dit, si les oeuvres d'art présentent des qualités intrinsèques, la question directrice inhérente à la démarche de Baumgarten ne peut donc nullement être celle d'une critique du goût, comme opération subjective {Le. relative au sujet, sans que cela soit forcément synonyme de « relativisme »), mais bien la quête d'un fondement qui soit en mesure de conférer à l'esthétique philosophique, en tant que métaphysique spéciale, sa légitimité.Ce qui distingue sur le plan philosophique le projet d'une métaphysique de l'Art de celui d'une esthétique du goût réside en ceci que le premier est guidé, a priori, par la nécessité de produire un discours valant universellement, indépendant des oeuvres d'art, tandis que le goût, pour s'exercer, implique toujours une oeuvre singulière, concrète, sans laquelle celui-ci ne reste qu'à l'état de potentialité. Le goût a trait au particulier et au contingent, sans être pour autant quelque chose d'aléatoire. En effet, il n'est pas un véritable philosophe s'interrogeant sur cette notion qui n'ait entrevu, d'une manière ou d'une autre, la nécessité de porter le goût à la hauteur d'un jugement, c'est-à-dire lui conférer au moins une règle ou une norme qui puisse le légitimer comme tel et le sauver du relativisme, pris en son sens le plus péjoratif. La délicatesse du goût va même jusqu'à être tenue pour une forme de « connaissance », par laquelle les choses sont appréhendées dans toute leur subtilité. Les différents auteurs évoqués pour cette question (Francis Hutcheson, David Hume, Alexander Gerard, Louis de Jaucourt, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Denis Diderot, Edmund Burke), soutiennent qu'il y a bien quelque chose comme des « normes » du goût, que celles-ci soient inférées des oeuvres de génie ou qu'elles soient postulées a priori, garanties par une transcendance divine ou par la bonté de la Nature elle-même, ce qui revient, en dernière instance au même puisque le geste est similaire : rechercher dans le suprasensible, dans l'Idée, un fondement stable et identique à soi en mesure de garantir la stabilité de l'expérience du monde phénoménal.La seconde partie de la recherche s'est articulée autour de la question suivante : est-ce que les esthétiques du goût qui mesurent la « valeur » de l'oeuvre d'art à l'aune d'un jugement subjectif et par l'intensité du sentiment échappent aux apories constitutives de la métaphysique de l'Art ?En un sens, une réponse partielle à cette question est déjà contenue dans l'expression « esthétique du goût ». Cette expression ne doit pas être prise au sens d'une discipline ou d'un corpus unifié : la diversité des positions présentées dans cette recherche, bien que non exhaustive, suffit à le démontrer. Mais ce qui est suggéré par cette expression, c'est que ces manières de questionner l'art sont plus proches du sens original du terme aisthêsis que ne l'est la première esthétique philosophique de l'histoire de la philosophie. L'exercice du goût est une activité propre du sentir qui, en même temps, est en rapport direct avec la capacité intellectuelle à discerner les choses et à un juger avec finesse et justesse.Avec le goût esthétique s'invente une espèce de « sens sans organe » dont la teneur ontologique est hybride, mais dont le nom est identique à celui des cinq sens qui procurent la jouissance sensible la plus immédiate et la moins raisonnable qui soit. Par la reconnaissance de l'existence d'un goût « juste » et « vrai », ou à défaut, au moins de l'existence d'une « norme » indiscutable de celui-ci, c'est-à-dire de la possibilité de formuler un jugement de goût une tentative inédite de spîritualisation de la sensibilité a lieu.Par conséquent, il est loin d'être évident que ce que j'ai appelé les esthétiques du goût échappent à un autre aspect aporétique de la métaphysique de l'Art, à savoir : passer à côté du caractère singulier de telle ou telle oeuvre afin d'en dégager les traits universels qui permettent au discours de s'étayer. Dans une moindre mesure, cela est même le cas dans les Salons de Diderot où, trop souvent, le tableau sert de prétexte à l'élaboration d'un discours brillant.Par contre, tout l'intérêt de la question du goût réside en ceci qu'elle présente, de façon particulièrement aiguë, les limites proprement métaphysiques dont l'esthétique, à titre de discipline philosophique, se fait la légataire et tente à sa manière d'y remédier par une extension inédite du concept de vérité et sa caractérisai ion en termes de vérité « esthéticologique » au paragraphe 427 de Y Esthétique. Cela dit, le fait même que dans l'empirisme la sensibilité s'oppose, une fois de plus, à l'intellect comme source de la naissance des idées - même si c'est dans la perspective d'une réhabilitation de la sensibilité -, indique que l'horizon même de questionnement demeure inchangé. Si le goût a pu enfin acquérir ses lettres de noblesse philosophique, c'est parce qu'il a été ramené, plus ou moins explicitement, du côté de la raison. Le jugement portant sur les arts et, de manière plus générale, sur tout ce qui est affaire de goût ne saurait se limiter au sentiment de plaisir immédiat. Le vécu personnel doit se transcender en vertu de critères qui non seulement permettent de dépasser le relativisme solipsiste, mais aussi de donner forme à l'expérience vécue afin qu'elle manifeste à chaque fois, et de façon singulière, une portée universelle.Le goût, tel qu'il devient un topos des discours sur l'art au 18e siècle, peut, à mon sens, être interprété comme l'équivalent de la glande pinéale dans la physiologie cartésienne : l'invention d'un « je ne sais quoi » situé on ne sait où, sorte d'Hermès qui assure la communication entre l'âme et le corps et sert l'intermédiaire entre l'intellect et la sensibilité. L'expérience décrite dans l'exercice du goût implique de facto une dimension par définition occultée par la métaphysique de l'Art : le désir. Pour goûter, il faut désirer et accepter d'être rempli par l'objet de goût. Dans l'exercice du goût, le corps est en jeu autant que l'intellect, il s'agit d'une expérience totale dans laquelle aucune mise à distance théorétique n'est, en un premier temps, à même de nous prémunir de la violence des passions qui nous affectent. L'ambiguïté de cette notion réside précisément dans son statut ontologiquement problématique. Mais cette incertitude est féconde puisqu'elle met en exergue le caractère problématique de la distinction entre corps et esprit. Dans la notion de goût est contenue l'idée que le corps pense aussi et que, par voie de conséquence, la sensibilité n'est pas dépourvue de dimension spirituelle. Reste que formuler les choses de la sorte revient à rejouer, en quelque sorte, l'antique diaphorâ platonicienne et à convoquer, une fois de plus, les grandes oppositions métaphysiques telles que corps et âme, sensible et intelligible, matière et forme.La troisième partie est entièrement consacrée à Shaftesbury qui anticipe le statut ontologiquement fort de l'oeuvre d'art (tel qu'il sera thématisé par Baumgarten) et l'allie à une critique du goût. Cet auteur peut être considéré comme une forme d'exception qui confirme la règle puisque sa métaphysique de l'Art laisse une place prépondérante à une critique du goût. Mais le cumul de ces deux caractéristiques opposées un peu schématiquement pour les besoins de la démonstration n'invalide pas l'hypothèse de départ qui consiste à dire que la saisie philosophique de la question du goût et l'invention conjointe de l'esthétique au 18e siècle sont deux tentatives de trouver une issue au problème du dualisme des substances.Cette recherche doit être prise comme une forme de propédeutique à la fois absolument nécessaire et parfaitement insuffisante. Après Baumgarten et le siècle du goût philosophique, les propositions de dépassement des apories constitutives d'une tradition qui pense l'art à partir de couples d'oppositions métaphysiques tels qu'âme et corps, forme et matière, ainsi que leurs traductions dans les arts visuels (dessin et couleur ou encore figuration et abstraction), n'ont pas manqué. Il aurait fallu in fine s'effacer pour laisser la place aux plasticiens eux-mêmes, mais aussi aux poètes, non plus dans l'horizon de Y ut pictura, mais lorsqu'ils expriment, sans verser dans l'analyse conceptuelle, leurs rencontres avec telle ou telle oeuvre (je pense à Baudelaire lorsqu'il évoque Constantin Guys, à Charles Ferdinand Ramuz lorsqu'il rend hommage à Cézanne ou encore à Pascal Quignard lorsqu'il raconte les fresques de la maison des Dioscures à Pompéi, pour ne citer que trois noms qui affleurent immédiatement à ma mémoire tant leur souvenir est vivace et leur exemple un modèle). Et puis il s'agit, malgré tout, de ne pas renoncer pour autant au discours esthétique, c'est- à-dire à la philosophie, mais de réinterroger les catégories dont nous sommes les légataires et de penser avec et au-delà des limites qu'elles nous assignent. Mais cela ferait l'objet d'un autre ouvrage.